« Du jamais vu » : la météo bouscule les semis et les assolements
TNC le 15/12/2023 à 18:13
Les forts cumuls de précipitations enregistrés depuis la mi-octobre sont venus perturber l’avancée des chantiers agricoles : récolte, semis, désherbage d’automne… Pour beaucoup d’agriculteurs, c’est « du jamais vu ». Pour cette campagne, l’adaptation reste donc encore le maître-mot… Retrouvez les témoignages d’agriculteurs sur le sujet.
« Avec cet automne extrêmement pluvieux, il y a au moins un avantage : les nappes phréatiques se rechargent. En revanche, c’est un peu plus compliqué pour les surfaces de céréales d’hiver », indiquait à l’occasion du dernier conseil spécialisé grandes cultures FranceAgriMer, son président Benoît Piètrement, également agriculteur dans la Marne. Depuis mi-octobre, les fortes perturbations perturbent l’avancée des chantiers agricoles.
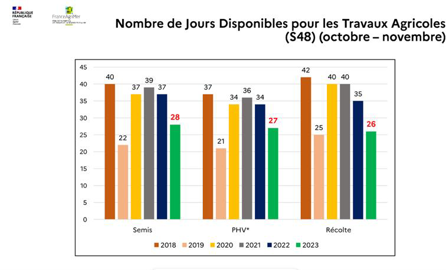
Au 4 décembre 2023, l’observatoire Céré’Obs comptait 89 % des surfaces de blé tendre emblavées. « Il en reste encore à semer. Moi le premier, j’ai un petit espoir d’en faire jusqu’à Noël. Mais c’est de moins en moins gagné, estime Benoît Piètrement. Beaucoup d’agriculteurs sont aujourd’hui dans l’interrogation… ».
Recul des surfaces de céréales d’hiver
Pour Bruno Melquioni, installé dans la région Rhône-Alpes, « c’est semé, mais pour certaines parcelles, il faut voir dans quelles conditions… Pas sûr que cela donne de très bons rendements », commente l’agriculteur sur la page Facebook de Terre-net.
« En Sologne bourbonnaise, on voit environ 30 % de la surface des parcelles semées qui ne vont pas lever et dont les grains pourrissent en terre, explique un autre lecteur. Là où ça ne pourrit pas, les plantules vont lever péniblement et être asphyxiées… Je ne parle même pas du désherbage. Dans ces conditions, il vaut peut-être mieux que le produit soit resté dans les bidons : ça fait moins de mal au blé, à l’environnement… et au porte-monnaie. »
Chez Nicolas, dans le sud de l’Aisne et le nord de la Seine-et-Marne, « les blés de maïs et de betteraves ont été semés avant les gros épisodes pluvieux : les terres sont glacées et les levées très hétérogènes. Céréales mal enracinées et dégâts de désherbage, ça ne sent pas bon pour la suite ! »
Voici l’orge semis y’a bientôt un mois 😕 très peu de levée. Beaucoup de pertes limaces 🐌 et pourrit dans le sol 85 mm depuis le semis et sans doute récolte à la charrue… pic.twitter.com/Fp1wpOrcr0
— roelofdeboer (@roelofdeboer) December 12, 2023
Il reste encore un tiers des betteraves sucrières à arracher pour Philippe Leveque, installé également au sud de l’Aisne. Ces surfaces seront emblavées en blé dur, d’ici février. L’agriculteur se dit plus inquiet quant aux parcelles de blé tendre et de colza implantées, « les protections herbicides et insecticides n’ont pas pu être réalisées comme il faudrait ». D’autant que l’agriculteur est concerné par des soucis de ray-grass et vulpins résistants. « Dans les terres avec 45 % d’argile, c’est impossible de passer », précise-t-il.
« Chez nous, il reste 90 % des semis à faire, indique Sébastien Debieu, dans le secteur du Bessin (Calvados) et pour ce qui est semé, ce n’est pas gagné partout ».
Au niveau national, le service statistique du ministère de l’agriculture a présenté ses premiers pronostics cette semaine pour la campagne 2023/2024, estimant notamment à 4,49 Mha les surfaces de blé tendre. Elles seraient en baisse de 5,1 % sur un an et de 4,7 % par rapport à la moyenne 2019-2023. « Je crains que ce ne soit pire, mais j’espère me tromper, commente Benoît Piètrement. Il y a encore pas mal d’incertitudes. »
Retrouvez les réponses d’un sondage publié sur Terre-net entre le 12 et le 15 décembre 2023 :
« Pour les surfaces déjà semées, qui souffrent de l’humidité, il faut voir comment elles vont passer l’hiver, ajoute Benoît Piètrement. On peut avoir un hiver hyper sympa, un printemps où tout se passe bien, un mois de juin où la maturité va très bien et cela permettra de compenser en grande partie, mais on n’en sait rien ». « Si les conditions de cultures actuelles ne sont pas optimales, cela reste rattrapable selon Arvalis », tempère également Abir Mahajba, cheffe du programme Céré’Obs – FranceAgriMer.
Avec des semis tardifs, « on perd de base un peu de potentiel. Mais on va surtout être attentif quant à la météo à venir et si le printemps va dans le bon sens », indique Jean-Louis Réveiller, conseiller agricole du CDPM, Comité développement plaine marais, basé dans le sud de la Vendée.
Adaptations techniques et révision des assolements
« Sur la partie plaine, on est à 80-90 % des semis réalisés et la plupart commencent tout juste à lever. Dans le Marais poitevin en revanche, il n’y a pas un grain semé, mais pour le blé dur, l’implantation reste possible jusqu’à la première quinzaine de mars environ. On bénéficie d’une réserve hydrique importante ».
« Pour les surfaces qui n’ont pas pu être semées, plusieurs vont sans doute être compensées par d’autres cultures, voire de la jachère, estime le président du conseil spécialisé grandes cultures de FranceAgriMer. On voit dans certains secteurs (comme le Grand Ouest), que les agriculteurs commencent à acheter des semences d’orge de printemps, il y a un peu de tensions à ce niveau. Je n’en ai pas vu encore sur les maïs, mais je pense que ce sera le deuxième effet ».
Des mouvements de céréales (blé notamment) à prévoir à la moisson à cause d’une forte inégalité entre régions?
Absorber 500 000ha de cultures de printemps supplémentaires : lesquels ? Quels impacts sur les filières, la logistique ?Sans compter ce qui sera à défaire …
— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) December 9, 2023
Agriculteur en Charente-Maritime, Thomas Poinot avait initialement prévu 30 ha d’orge d’hiver pour la récolte 2024 : « j’ai finalement retourné les semences afin de prévoir plutôt de l’orge de printemps en début d’année, en espérant que l’eau ne remonte pas », indique-t-il. Dans son secteur, le cumul de précipitations dépasse les 510 mm depuis la mi-octobre, contre un cumul annuel moyen autour de 800 mm.
« Sur les 130 ha de blé tendre, 98 ha sont implantés, 10 vont être basculés en culture de printemps : soit maïs, soit tournesol. Cela concerne surtout les bas de champs, plus humides. C’est un des enseignements de l’automne pluvieux 2019 : les passages en force n’avaient pas été concluants à ces endroits. Il me reste donc encore 22 ha de blé à semer, et j’ai conservé les variétés les plus adaptées pour cela ». L’agriculteur ne compte pas étendre davantage la part de son assolement dédié aux cultures de printemps : « dans nos terres argilo-calcaires superficielles, on ne peut pas se le permettre. Les bonnes années, on peut espérer 15 à 20 q/ha en tournesol ou 30 q/ha en pois protéagineux maximum ».
La semence en pois de printemps🫛et du #PlanProtéine arrive.
Je vois que les quantités progressent chez les #Agricultures de l’Yonne.
✅Est-ce le défaut d’une germination de leur R2 ?
✅Est-ce les mauvaises conditions de semis pour les pois d’hiver ?
✅Est-ce une 📈des surfaces ? pic.twitter.com/z8PyfSsMfM— Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) December 13, 2023
« Du jamais vu ! »
Dans son secteur, les techniciens estiment à environ 60 % les surfaces semées dans la plaine, mais c’est beaucoup moins que ça dans le marais, en grande partie inondé. « Certaines exploitations ont même dû être évacuées avec leurs troupeaux. La demande d’aide faite au département a été refusée, les agriculteurs viennent avec des pompes pour tenter de vider l’eau du marais. C’est du jamais vu, comme le dit mon grand-père installé dans la région depuis les années 70. L’automne 2019 à côté, c’était de la rigolade, selon Thomas Poinot. On n’avait pas reçu de si importants cumuls et cela avait été plus échelonné ».
Quelle misère 😑 pic.twitter.com/3nGthIYoaf
— Thomas (@toto_bricolo) December 12, 2023
« Ces derniers jours, on a eu environ 100 mm, l’eau est remontée partout dans les parcelles, qui sont entre le stade germination et 1 feuille. J’ai demandé l’accord aux maires pour poser des buses et évacuer l’eau, afin d’essayer de limiter les dégâts. » Dans ces conditions, l’agriculteur de Charente-Maritime n’a, pour le moment, pas avancé dans les désherbages, « à voir en fin d’année ou en sortie d’hiver ? ».
Inquiétudes vis-à-vis de l’organisation du travail et d’un possible manque de paille
Beaucoup de questions se posent aussi pour Nicolas Gaillard, installé en polyculture-élevage dans le nord de la Dordogne : « on était à 750 mm de pluie à la mi-octobre et depuis, on compte près de 780 mm supplémentaires ». Là encore, « c’est du jamais vu : plus de 1 530 mm contre un cumul annuel moyen de 800 mm ». « Dans la région, environ 35 à 45 % des semis sont faits et moins de 10 % sont levés. L’arrivée du gel début décembre (jusqu’à – 6,5°C un matin) a aussi fait des dégâts… ».
« Il me reste environ 40 ha de céréales à semer, en blé et triticale alternatifs pour ce qui est possible et de l’orge de printemps. La coopérative n’accepte pas le retour de semences… Pour les terrains encore impraticables, on réfléchit aussi à du blé de printemps, du maïs ou du tournesol, on ne sait pas trop encore. »
Fini ça ne sera pas de l’opa sur certaines parcelles mais de l’op classique. Je ne sais pas si il faut regretter de ne pas avoir semé, mais des coins auraient pourris même en semis en bonne condition, sur le gel, il y a 10 jours pic.twitter.com/H3ONyu1TRf
— guigui (@Guiguiperdereau) December 12, 2023
Dans le secteur, le potentiel des céréales réduit inquiète les éleveurs quant à un possible manque de paille… Étant entrepreneur de travaux agricoles en parallèle, Nicolas Gaillard craint également des soucis dans l’organisation du travail avec « les semis étalés, des parcelles entamées, mais pas terminées, des ornières dans les champs…. Cela va chambouler les interventions tout au long de l’année et les chantiers de récolte ». « La période de mise-bas des brebis et les travaux dans les champs ne sont pas finis pour cet hiver. »



